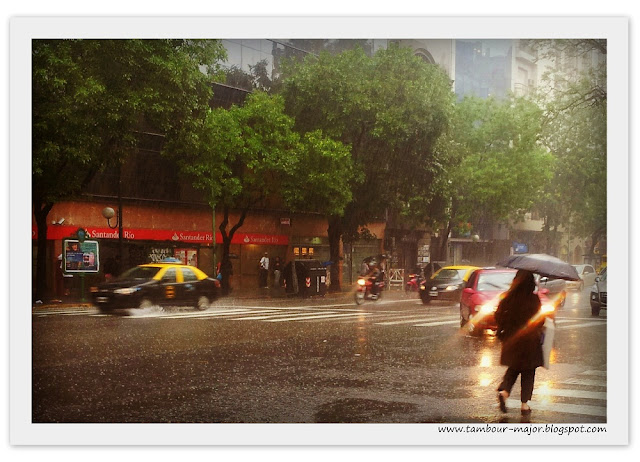Aller au Chili, je m'étais promis de le faire dès avant mon départ pour l'Argentine. Quitte à être en Amérique du Sud, autant en profiter !
Alors, pour passer les fêtes de fin d'année je me suis octroyé un petit voyage. Ho, trois fois rien : 48 heures de bus, plus de 3000 kilomètres à parcourir au total, dénivelé cumulé d'environ 6000 mètres, température ambiante d'environ 30°C...
Voilà mon programme pour les prochains jours. J'embarque en effet ce soir pour Mendoza, au pied de l'Aconcagua, première étape d'un long périple qui me conduira ensuite au coeur des Andes afin de rejoindre Santiago du Chili, puis Valparaiso où je passerai la soirée de nouvel an.
Voilà mon programme pour les prochains jours. J'embarque en effet ce soir pour Mendoza, au pied de l'Aconcagua, première étape d'un long périple qui me conduira ensuite au coeur des Andes afin de rejoindre Santiago du Chili, puis Valparaiso où je passerai la soirée de nouvel an.
Plutôt que l'avion, j'ai opté pour le bus, un moyen transport certes beaucoup plus lent mais aussi beaucoup moins cher et qui, surtout, offre l'avantage non-négligeable de profiter du paysage. Et du paysage, je vais en voir ! Un programme un peu fou mais la folie des grands espaces pousse à la démesure. Voyager en bus en Argentine - et un peu partout en Amérique Latine - est chose commune, d'autant que le niveau de confort des longs courriers est sans équivalent en Europe.
Surtout, le clou du spectacle de cette expédition sera la traversée des Andes avec un passage de frontière à plus de 3000 mètres d'altitude, au pied d'un des plus hauts sommets du monde. Sept heures de trajet au coeur de la mythique chaîne de montagnes dans laquelle se sont illustrés - précisément en avion - un Mermoz ou un de Saint-Exupéry...
« ...
Le 9 mars 1929, à 10 heures du matin, Mermoz ayant Collenot derrière lui (son mécanicien attitré) quitta le terrain de Copiapo. Il monta par lente spirales à l’altitude limite que lui permettait son appareil : 4200 m. Devant lui, la paroi cyclopéenne de la Cordillère des Andes. Rien ne peut donner une image valable de cet océan vertical pétrifié.
Cette barrière, Mermoz voulu la prendre en défaut. Longtemps, très longtemps, il croisa, il roda devant elle. Il ne trouva pas, du moins à l’altitude que son appareil ne pouvait dépasser. Jusqu’à 4500 m, la montagne lisse, d’un joint, d’un bloc, était inattaquable. A 4500 m, entre les pics neigeux régulièrement plantés, des jours s’ouvraient. « On peut passer les Andes utilement pour la ligne à 4500 m. » se dit Mermoz excédé par sa croisière inutile. « En dessous, rien à faire. »
Tout autre que Mermoz fut revenu à Copiapo, eut contourné l’obstacle infranchissable par le Nord ou par le Sud et attendu, pour recommencer d’avoir un appareil capable de se mesurer avec quelques chances d’égalité à la montagne impitoyable. Mais Mermoz était Mermoz. Il ne croyait pas à l’impossible, ou plutôt avant de l’admettre, il épuisait tous les risques et allait jusqu’à une zone où personne que lui ne se fut aventuré. Il avait toujours la perception intuitive de la marge suprême. Ce qu’on a appelé son génie.Contemplant le front dentelé de la Cordillère des Andes, Mermoz se dit encore : » pour passer, il manque à mon appareil 300 m d’altitude. Mais il y a les courants ascendants. »Mermoz se remis à croiser devant la paroi gigantesque en guettant les mouvement de l’air. La première ondulation qu’il sentit sous ses ailes fut insuffisante et il évita de justesse, par un renversement, le choc mortel contre le roc, mais il était presque arrivé à la hauteur d’une faille. Il manqua une seconde vague, une troisième. A la quatrième, plus puissante, il se sentit comme appuyé, comme vissé à une colonne qui s’élevait. Il arriva à la ligne jusque là interdite. Un corridor s’ouvrit devant lui entre deux murs de neige. La barrière était vaincue. Il sautait par dessus elle. Il était passé.
La joie d’avoir forcé la nature illumina Mermoz en cet instant où il se trouva de l’autre côté de la muraille des Andes, et où, vers l’est, des crêtes n’arrêtaient plus son regard. Il allait les survoler, il allait…. Mais quelle était cette chute brutale de l’appareil, contre quoi, tous muscles raidis, moteur lancé à plein régime, il ne pouvait rien ? Quel était ce vide qui l’aspirait ?(...)Il bondit, retomba, bondit de nouveau, roula en cahotant et s’affaissa.Mermoz et Collenot se regardèrent avec un profond soupir. Dans cette première minute, la joie et la stupeur de vivre encore, de vivre tout de même, les emplit entièrement. Elle fut fugitive, Mermoz n’avait-il pas simplement reculé leur mort de quelques heures, et quelles heures ! Ils étaient sur un plateau en pente douce cerné par des ravins profonds. Tout autour, dans un désordre fantastique et grandiose, scintillait les croupes, les cimes, les arêtes et les pics. Un désert de pierres et de neige s’étendait à perte de vue. Et un silence, un silence sans nom. (...)
« On y arrivera se répétait Mermoz, tout en sachant que la Cordillère n’avait jamais rendu encore les pilotes qui s’étaient égarés dans ses plis. Mermoz et Collenot descendirent, gravirent des pentes, trébuchant dans des pièges invisibles, glissant sur la glace, tombant dans la neige. Trois condors les suivaient d’un vol concentrique. (...)
Ils se mirent au travail. Collenot dirigeait Mermoz. Il faudrait avoir l’expérience et le don d’un mécanicien génial, pour dénombrer et comprendre les gestes que fit Collenot, ses trouvailles, ses inspirations, et comment il arriva à redresser le train d’atterrissage, remplacer la béquille, assurer la solidité du fuselage, rendre inoffensives les avaries du moteur. Il tordait le fil de fer, triturait la tôle, enlevait à l’avion des pièces secondaires pour en faire des pièces essentielles, transformait le métal, lui donnait une vie nouvelle. La ficelle lui servit aussi, et les bouts d’étoffe et de cuir. Etrange atelier en plein vent, en pleine neige, à 4000 m de haut, avec trois condors fichés sur les pics voisins comme de lugubres sentinelles.
La nuit n’arrêta pas ce labeur. Le froid engourdissait leurs mains et brûlait leur corps, la faim les affaiblissait. Pour apaiser leur soif, ils mangeaient de la neige. Parfois, ils se serraient l’un contre l’autre dans la cabine de l’avion pour se réchauffer.
A l’aube, Collenot moins résistant que Mermoz commença à subir les effets du mal de montagne. Il saigna du nez et des oreilles. Des étourdissements le firent vaciller, pourtant il n’arrêta pas son labeur durant toute la journée qui suivi. Le soir, il n’avait pas terminé. Le froid cette nuit là fut plus vif encore. A demi gelés, exténués de faim, la tête bourdonnante, Mermoz et Collenot se couchèrent dans la cabine des passagers. Ils mêlèrent leur chaleur, leur respiration.
Avec le soleil, Collenot se remit à l’ouvrage. Mermoz, évitant de regarder les condors, se promena longuement le long du plateau, examina le terrain pied par pied.La matinée était à peine commencée lorsque Collenot dit : « Monsieur Mermoz, je crois qu’on peut essayer le moteur ». Quel chant d’orgue dans la Cordillère ! Les deux amis l’écoutèrent religieusement. Pas une défaillance, pas une fausse note. (...)
Durant l’exploration minutieuse qu’il avait faite des environs, Mermoz avait conçu , pour le décollage, un plan d’une hardiesse insensée, mais qui lui apparut comme le seul moyen possible de salut. (...)
Il fallait sauter, il sauterait. Mais pour que ce projet, qui comportait une chance sur mille de réussite, reçut un commencement d’exécution, il devait donner à la course initiale de l’avion le plus de champ possible, c’est à dire le pousser jusqu’au sommet du plateau. Mermoz et Collenot délestèrent le Laté 25 de tout ce qui n’était pas strictement indispensable ; ils abandonnèrent sur la neige un réservoir d’essence de 480 litres avec ses ferrures, les tire-bouchons d’amarrage, l’outillage de l’avion, le cric, des bidons d’huile. Ils arrachèrent les banquettes de la cabine des passagers. Le Laté 25 semblait sortir d’un pillage. Malgré cela, il pesait encore plus de 2000 kilos. Et deux hommes, qui depuis cinquante heures n’avaient rien mangé, presque pas dormi, que le gel avait torturés, devaient le faire rouler, en remontant la pente, sur une piste rocheuse pendant un demi kilomètre. Et Collenot tenait à peine sur ses jambes. Mermoz mit huit heures à parachever cet exploit.Puis ils tournèrent l’avion le nez vers l’abîme. (...)
Collenot écarta les grosses pierres posées sous les roues, sauta dans la cabine. L’avion roulait. Avec ce qui restait de sa veste, Collenot se couvrit la tête. Il ne voulait pas voir.Mermoz, le visage pareil à un masque, sentait chaque tressaillement de l’appareil dans sa chair. Plein moteur… Le bord de la pente, la chute, le premier tremplin. Le train d’atterrissage a tenu… Le second obstacle… Un mètre d’erreur et c’est la fin. La roue du gouvernail lui entrait dans les paumes... L’endroit juste ou il faut toucher…. Le Laté rebondit… Le train a tenu… Attention… Le troisième ravin…. Ne pas se tromper d’un mètre… Je touche… Je saute. Oui… Le train a tenu.A deux mains, Mermoz appuya sur le levier de profondeur, tomba dans la vallée, sentit s’éveiller à la vie les molécules de l’appareil, vira sur l’aile pour éviter le flanc de la montagne qui venait à lui avec une vitesse incroyable, redressa, remonta. Il était maître de l’avion, du ciel, du monde.
Par le couloir qu’il avait emprunté pour venir, et s’appuyant de nouveau sur un courant ascendant, il déboucha de la muraille tragique. La plaine frémissante d’arbres en fleurs reposait sous le soleil à son zénith.A midi, Mermoz était à Copiapo.
Ceux qui l’ont vu atterrir, m’ont dit que son visage et celui de Collenot étaient méconnaissables. Sous la barbe qui les rongeait, le froid n’en avait fait qu’une plaie.Des deux côté de la Cordillère, en Argentine comme au Chili, dès qu’on l’avait su perdu dans la montagne barbare, on avait renoncé à l’espérance de le revoir. Seuls ses amis refusaient d’accepter qu’il fût mort. Leurs occupations ordinaires, ils n’y pouvaient songer. Ils ne pouvaient que parler de Jean, calculer ses chances.
Le téléphone leur apporta à Buenos-Aires la nouvelle que Mermoz était à Copiapo. C’était à ce point un miracle que lorsqu’il raconta son aventure, les chiliens ne crurent pas Mermoz. Pourtant ils comptaient parmi leurs pilotes, et plus que tout autre peuple peut-être, des gens d’une bravoure démente et prêts à tous les risques. Mais ils savaient que la Cordillère ne rendait jamais ceux qu’elle avait pris. Ils envoyèrent une caravane à dos de mulet, à l’endroit qu’indiqua Mermoz comme ayant été celui de son décollage. Elle revint avec le réservoir d’essence, le cric, les banquettes arrachées. Alors seulement le prodige fut accepté pour vrai. Et la renommé de Mermoz, comme d’un être surnaturel, courut d’un bord à l’autre de l’Amérique du sud. Et comme sa stature et son visage se prêtaient à la légende, les Indiens des Andes et les gauchos des pampas et les péones du Paraguay, et les pécheurs du Brésil parlèrent d’un demi-dieu venu de France, qui volait comme un oiseau, et qui avait la force des montagnes.
Dans les mois d’avril et de mai, Mermoz maîtrisa la Cordillère. Il avait enfin reçu de France un appareil qui pouvait s'élever jusqu’à 6000 m : le Potez 25. Il ne s’agissait plus de louvoyer, de ruser avec la montagne. Il pouvait l'attaquer de front, aller droit, aller vite.... »
Extraits de « Mermoz » de Joseph Kessel – Éditions Folio.
Bon, c'est pas tout mais j'ai une valise à préparer.
Mais où ai-je donc mis ma crème solaire...?